SYMPOSIUM INTERNATIONAL ET INTERDISCIPLINAIRE
Langues, communication et santé mentale en contexte humanitaire
Contexte et justification
Dans un contexte international de plus en plus instable, marqué par une multiplication des conflits armés, une dégradation continue des droits humains et une fragmentation croissante des alliances politiques, les crises humanitaires se complexifient et s’intensifient. À cette réalité s’ajoute une anxiété sociopolitique diffuse, alimentée par l’incertitude persistante quant à l’avenir de la paix, à la solidité des engagements internationaux, et à la durabilité du soutien aux actions humanitaires.
Cette anxiété n’est pas seulement une affaire de gouvernements, d’institutions ou de diplomatie. Elle se traduit dans les corps et les esprits, elle traverse les camps de réfugiés, les centres de santé, les zones frontalières, et se loge dans les interstices du soin. Elle affecte autant les populations déplacées que les professionnel·le·s engagé·e·s dans l’aide, pris·e·s dans des systèmes mouvants, imprévisibles, parfois contradictoires.
C’est dans ce contexte troublé que se tient ce symposium interdisciplinaire consacré à la communication et à la santé mentale en contexte humanitaire avec un focus particulier sur les langues minoritaires. En réunissant des spécialistes issus de divers horizons et spécialités, cette rencontre vise à mettre en lumière les tensions, les impasses mais aussi les ressources qui émergent lorsqu’il s’agit de prendre soin de la souffrance psychique dans un monde où les repères vacillent et les alliances se fragilisent.
Car la parole, dans ces contextes, devient une zone de contact parfois douloureuse, souvent incertaine. Elle peut permettre la reconnaissance mutuelle, mais aussi révéler l’ampleur du malentendu. Elle peut soigner, comme elle peut échouer à faire lien. Lorsque les langues diffèrent, que les référentiels culturels s’éloignent, que les temporalités du soin et celles de la survie se heurtent, la communication devient un enjeu fondamental de la relation thérapeutique. Et ce qui se joue là ne peut être dissocié de l’état général du monde : les effets de l’exil, de la guerre, de la répression ou de l’effondrement des structures sociales s’inscrivent dans les corps, mais aussi dans les récits, les mots disponibles, les silences imposés.
Ce qui se dit ou ne se dit pas dans un entretien psychologique est lié à l’histoire individuelle, bien sûr, mais aussi aux rapports de pouvoir, aux imaginaires locaux, aux politiques de l’asile, aux stigmatisations sociales et aux régimes de vérité en place. Parler de santé mentale dans ces conditions, c’est parler de rapports entre personnes, mais aussi de relations entre États, de conflits entre systèmes de valeurs, de différends sur ce que signifie « guérir », « écouter », « prendre soin ».
L’anxiété géopolitique actuelle rejaillit jusque dans les pratiques les plus concrètes des professionnel·le·s de terrain. L’insécurité des financements, la fermeture de certaines missions, l’instrumentalisation politique des interventions médicales ou psychologiques pèsent sur les modalités d’action et sur les formes d’engagement. Dans ce contexte, les soignant·e·s doivent faire preuve d’une capacité constante d’adaptation, d’invention et de positionnement éthique. La communication devient alors un acte profondément politique, dans le sens où elle engage des manières d’être en lien, de reconnaître l’autre, de produire du sens commun au sein de contextes profondément fragmentés.
Les intervenant·e·s du symposium viendront de divers horizons géographiques, culturels et disciplinaires. Psychiatres, psychologues, anthropologues, linguistes, coordinateur·rice·s de missions, militant·e·s, traducteur·rice·s ou chercheur·e·s viendront croiser leurs perspectives pour aborder, chacun à leur manière, les enjeux de la langue et de la communication en santé mentale dans les situations d’urgence. Des présentations de recherches, des analyses de terrain, des récits de pratiques et des formats participatifs rythmeront la rencontre. Il ne s’agit pas d’enfermer la réflexion dans un cadre académique, mais de créer un espace vivant, mouvant, à l’image des contextes dans lesquels nous intervenons.
Au cœur de toutes ces réflexions, une même question traversera les échanges : que signifie vraiment « écouter » en contexte humanitaire, dans un monde traversé par la peur, l’incertitude, la défiance ? Car les contextes humanitaires, qu’ils soient liés à des conflits armés, des déplacements de populations, des catastrophes naturelles ou des crises sanitaires, génèrent des environnements d’intervention multiculturels et multilingues.
Objectifs du symposium
- Interroger la manière dont les langues et la communication influencent l’accès, la qualité et l’efficacité de l’accompagnement psychologique en contexte humanitaire ;
- Explorer le rôle des langagiers et autres médiateur·rice·s culturels dans les dispositifs de soin en santé mentale ;
- Analyser les représentations culturelles du soin psychique et leurs effets sur la relation thérapeutique ;
- Proposer des pistes de formation, de recherche et de bonnes pratiques pour améliorer les interventions sur le terrain.
Programme prévisionnel (provisoire)
9h00 – Accueil café et introduction
Accueil des participant·e·s.
Mot de bienvenue.
Programme de la matinée
09h30– 10h00 : Prof. Mathieu Guidère (INSERM, France) : « Communication et santé mentale en contexte humanitaire : langues, cultures et nouvelles technologies »
Cette communication inaugurale vise à articuler différents aspects du symposium : les enjeux linguistiques, les dynamiques interculturelles, les approches cliniques, les dimensions politiques de la communication humanitaire, ainsi que les impacts émergents de l’intelligence artificielle dans les pratiques de soin en situation de crise.
10h00 – 10h30 : Prof. Louis Jehel (CHU Amiens, France) : « Psychotraumatismes et interactions culturelles en contexte humanitaire »
À partir d’expériences de terrain en zone de crise ou de guerre, cette communication interroge les tensions entre les grilles de lecture occidentales du psychotraumatisme et les représentations locales de la souffrance psychique. Des concepts comme les « scripts culturels du trauma » ou les syndromes spécifiques (Susto, Khal’a, Khyâl cap…) éclairent la manière dont les traumatismes sont compris localement.
10h30 – 10h45 : Période de questions
Pause-café (15 mn)
11h00 – 11h30 : Dr. Catherine Bertrand (SFMC, France) : « La santé mentale en médecine de catastrophe : enjeux cliniques et éthiques »
Cette communication explore la dynamique de la triade soignant·e–interprète–patient·e dans les contextes de déplacement forcé. Elle met en évidence les malentendus culturels fréquents, les risques de distorsion de sens, mais aussi les possibilités d’alliance thérapeutique dans le contexte des catastrophes naturelles ou industrielles.
11h30 – 12h00 : Dr. Franck Peinaud (CRGN, France) : « Le paradoxe de la sécurité en contexte humanitaire : comment la sécurité peut générer de l’anxiété »
Cette communication interroge le paradoxe de sécurité dans les missions humanitaires qui génère une anxiété inattendue chez les intervenants alors même qu’elle est censée leur apporter la sérénité. Les ONG et les bailleurs internationaux accordent de plus en plus d’importance à la sécurisation des missions mais cette exigence est rarement intégrée dans une approche globale de la santé mentale.
12h00 – 12h15 : Période de questions
12h15-13h45 : Pause déjeuner
Programme de l’après-midi
En cours d'élaboration avec les intervenants pressentis.
16h30 – 16h45 : Période de questions
17h00 – Clôture du colloque et remerciements
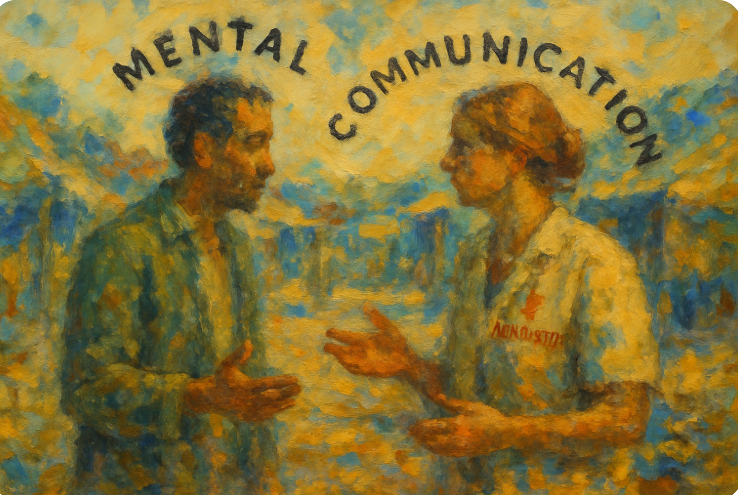



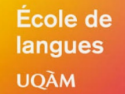

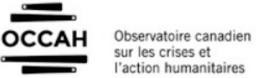
ÉVÉNEMENT
Vendredi 17 octobre 2025 à l'UQÀM
Dans un contexte international de plus en plus instable, marqué par une multiplication des conflits armés, une dégradation continue des droits humains et une fragmentation croissante des alliances politiques, les crises humanitaires se complexifient et s’intensifient. À cette réalité s’ajoute une anxiété sociopolitique diffuse, alimentée par l’incertitude persistante quant à l’avenir de la paix, à la solidité des engagements internationaux, et à la durabilité du soutien aux actions humanitaires.
Cette anxiété n’est pas seulement une affaire de gouvernements, d’institutions ou de diplomatie. Elle se traduit dans les corps et les esprits, elle traverse les camps de réfugiés, les centres de santé, les zones frontalières, et se loge dans les interstices du soin. Elle affecte autant les populations déplacées que les professionnel·le·s engagé·e·s dans l’aide, pris·e·s dans des systèmes mouvants, imprévisibles, parfois contradictoires.
C’est dans ce contexte troublé que se tient ce symposium interdisciplinaire consacré à la communication et à la santé mentale en contexte humanitaire avec un focus particulier sur les langues minoritaires.
